La science est l’exploration systématique du monde naturel par l’observation, l’expérimentation et un raisonnement fondé sur des preuves, dans le but d’approfondir notre compréhension du monde. Elle nait de la curiosité humaine et fait appel à la créativité, à l’imagination et à l’intuition, pour favoriser la découverte de nouvelles connaissances.
La science repose sur un ensemble de savoirs établis et propose un cadre conceptuel permettant de générer de nouvelles idées sur le monde naturel. Elle est influencée par des facteurs historiques, politiques, économiques, environnementaux et sociétaux, qui sont essentiels à la compréhension de sa valeur en tant qu’entreprise humaine fondamentale.
La science joue un rôle essentiel dans la compréhension de phénomènes, la résolution de problèmes et le développement de nouvelles technologies. En étudiant les sciences de la nature, les élèves développent leur littératie scientifique; ils enrichissent leurs connaissances, affinent leur pensée critique, renforcent leur capacité à analyser des données, et apprennent à évaluer efficacement des démarches scientifiques. La littératie scientifique permet aux élèves de discuter de l’information de manière critique, de prendre des décisions éclairées et de traiter des enjeux complexes d’ordres personnel, sociétal et environnemental. L’enseignement des sciences contribue à la réalisation d’une citoyenneté responsable, nourrit la curiosité et encourage une pensée interdisciplinaire grâce à ses liens avec les mathématiques, le génie, les arts, les langues, l’éducation physique, l’éducation à la santé et les sciences humaines.
Au Manitoba, l’éducation scientifique de la maternelle à la 10e année repose sur les cinq domaines suivants :
Les apprentissages dans les domaines des connaissances scientifiques et de la nature de la science sont organisés autour de quatorze notions-clés* de science et sur la science. Les dix notions-clés de science sont traitées à travers les apprentissages de connaissances scientifiques qui sont spécifiques à chaque niveau scolaire, alors que les quatre notions-clés sur la science sont explorées à travers les apprentissages de la nature de la science sur quatre stades progressifs. L’intention du domaine portant sur les peuples autochtones au sein du monde naturel est d’assurer que les savoirs, savoir-être et savoir-faire des Premières Nations, Inuit et Métis par rapport aux sciences sont infusés dans les cours de sciences. Le sentiment d’appartenance des élèves envers les sciences de la nature est abordé dans le domaine portant sur l’identité scientifique. Le domaine de la science en pratique met en lumière le fait que la science est active et participative.
Ces domaines entrelacés, sur lesquelles reposent la structure des apprentissages, placent les élèves sur un parcours où leur littératie scientifique peut continuellement s’étoffer. Ils cultivent leurs compétences globales, ce qui leur permet alors de participer de manière authentique au programme d’études et de consolider des apprentissages durables en science. De plus, l’apprentissage en sciences de la nature tient compte du rôle de l’école française en milieu minoritaire et de la construction langagière, identitaire et culturelle, ainsi que des principes de l’apprentissage et de l’évaluation. Les élèves sont exposés dans cette discipline à la fois à des modèles scientifiques et à des modèles culturels et langagiers.
* Voir Harlen, W. (2015). Idées de sciences, idées sur la science (traduit par M. Labonde). Éditions Le Pommier.

La pensée critique en sciences de la nature consiste à utiliser des preuves basées sur l’observation, l’expérience et l’expérimentation pour tester des idées, résoudre des problèmes, et approfondir sa compréhension des concepts scientifiques. La pensée critique est une composante essentielle à l’investigation scientifique et nécessite l’utilisation de divers processus et de nombreuses sources de preuves pour distinguer les informations exactes et fiables des informations biaisées ou erronées. Penser de façon critique permet de découvrir les relations dans et entre des phénomènes variés. Des théories sont élaborées et testées; elles peuvent être consolidées, remises en question, modifiées, ou abandonnées.
Lorsque la pensée critique est mobilisée en sciences, les élèves :

La créativité en sciences de la nature stimule l’exploration des idées, des processus, des problèmes et des enjeux scientifiques. La science est un processus profondément créatif visant à générer de nouvelles idées, à concevoir des produits et des processus innovateurs, et à obtenir des preuves menant à une prise de décisions éclairée. Les scientifiques utilisent l’imagination et les preuves disponibles pour proposer des théories ou des modèles expliquant les phénomènes dans le monde qui nous entoure et ils conçoivent des expériences pour tester ces théories. Ce processus peut entraîner des changements dans la compréhension humaine et mener à de nouvelles technologies.
Lorsque la créativité est mobilisée en sciences, les élèves :

La citoyenneté en sciences de la nature consiste en la capacité à reconnaitre et à comprendre les conséquences des décisions et des pratiques en sciences sur soi-même, les autres et le monde naturel. La méthodologie utilisée en science reconnait la faillibilité des facultés humaines, incluant les limites de l’observation et les biais naturels. Un scientifique exerce son rôle de citoyen en soumettant ses idées à la révision par les pairs et en reconnaissant la diversité et la richesse des personnes et des cultures qui contribuent à notre compréhension du monde. Les connaissances scientifiques accumulées à travers le monde peuvent aider à la durabilité et à l’amélioration du monde; elles devraient être recueillies de manière éthique, partagées volontairement et transmises de génération en génération.
Lorsque la citoyenneté est mobilisée en sciences, les élèves :

La connaissance de soi en sciences de la nature permet aux apprenants de développer une confiance en soi et un rapport positif vis-à-vis des sciences. La pensée scientifique est une habileté qui peut être développée et qui a des applications utiles dans la vie quotidienne. Faire de la science nécessite une prise de risque prudente, de la curiosité, une évaluation analytique de ses croyances, et une volonté de grandir et de changer fondée sur de l’information vérifiable. Pratiquer la science développe la résilience et la persévérance et promeut une compréhension de sa place au sein du monde naturel.
Lorsque la connaissance de soi est mobilisée en sciences, les élèves :

La collaboration en sciences de la nature consiste à apprendre des autres et avec les autres pour élaborer des idées scientifiques et des processus. Le processus d’évaluation par les pairs et la recherche du consensus sont des pratiques essentielles aux sciences. Les développements en sciences se produisent par l’entremise de collaboration entre scientifiques et équipes de scientifiques.
Lorsque la collaboration est mobilisée en sciences, les élèves :
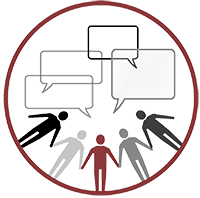
La communication en sciences de la nature consiste en une interaction avec autrui pour échanger des idées et des informations scientifiques dans divers contextes. La communication claire de l’information est centrale à l’œuvre scientifique. Ce qui est communiqué en tant qu’information scientifique doit être crédible, ouvert au questionnement d’experts et testable par l’observation ou l’expérimentation. La communication scientifique transmet souvent de l’information sous formes mathématique, graphique, ou technique. Les limitations liées à l’investigation doivent être prises en compte. Le langage et les symboles peuvent être très spécialisés et la communication entre domaines scientifiques et la vulgarisation au grand public nécessitent souvent une interprétation par des enseignants, des journalistes et d’autres communicateurs scientifiques.
Lorsque la communication est mobilisée en sciences, les élèves :
Les sciences de la nature expliquent les phénomènes naturels.
Les sciences de la nature expliquent les causes des phénomènes observés dans le monde naturel en utilisant diverses pratiques pour y parvenir.
Les sciences de la nature vivent à travers un effort collectif.
Les sciences de la nature vivent grâce à un effort humain collectif, qui permet de découvrir des lois, de construire des modèles, et de formuler des théories, qui correspondent le mieux aux données disponibles à un moment donné.
Les sciences de la nature et la technologie sont interconnectées.
Les sciences de la nature nourrissent une relation symbiotique entre les connaissances scientifiques et les développements technologiques dans le but de résoudre des problèmes.
Les sciences de la nature ont des implications complexes.
Les sciences de la nature et ses applications ont des implications éthiques, sociales, personnelles, économiques, politiques, culturelles et environnementales, comme la prise en compte de la durabilité et de la justice sociale.
Les sciences de la nature équipent les apprenants avec la capacité d’agir.
Les sciences de la nature renforcent la capacité d’agir et le développement d’une identité scientifique qui permet de cultiver un intérêt pour la science tout au long de la vie, ainsi que d’éclairer la prise de décision dans la vie quotidienne.